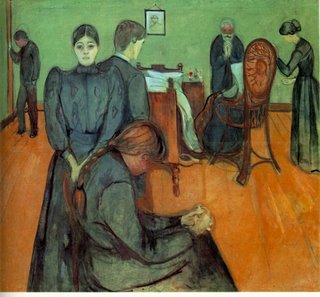Diogenês Laertios, Giovan Battista Langetti, 1650.
Diogène, fils du banquier Ikésios, naquit à Sinope. Il s’enfuit, raconte Dioclès, quand son père, qui tenait la banque publique, fabriqua de la fausse monnaie. Eubulide, dans son livre sur Diogène, accuse de ce crime notre philosophe, et dit qu’il s’enfuit avec son père. Quoi qu’il en soit, Diogène lui-même s’accuse dans le Pordalos d’avoir falsifié la monnaie. Quelques auteurs racontent qu’étant inspecteur de la monnaie, il reçut d’ouvriers le conseil d’aller à Delphes ou à Délos, patrie d’Apollon, pour demander ce qu’il devait faire. L’oracle lui permit de faire la monnaie de l’État. Ayant mal interprété la réponse, il falsifia la monnaie, et, pris sur le fait, il fut condamné à l’exil, disent les uns, il s’enfuit par crainte d’un châtiment, disent les autres. On croit encore qu’il falsifia de l’argent que son père lui avait donné, que son père, jeté en prison, y mourut, et que lui-même, condamné à l’exil, s’en vint à Delphes, non pas pour savoir s’il pouvait falsifier la monnaie, mais pour savoir de quelle façon il pouvait devenir illustre, à quoi l’oracle lui répondit. Venu à Athènes, il s’attacha à Antisthène. Celui-ci le chassa parce qu’il ne voulait pas de disciples, mais il ne put rien contre la ténacité de Diogène. Un jour où il le menaçait d’un bâton, notre philosophe tendit sa tête et lui dit : « Frappe, tu n’auras jamais un bâton assez dur pour me chasser, tant que tu parleras ! » Il devint donc son auditeur et vécut très simplement, comme il convenait à un homme exilé.
Ayant vu un jour une souris qui courait sans se soucier de trouver un gîte, sans crainte de l’obscurité, et sans aucun désir de tout ce qui rend la vie agréable, il la prit pour modèle et trouva le remède à son dénuement. Il fit d’abord doubler son manteau, pour sa commodité, et pour y dormir la nuit enveloppé, puis il prit une besace, pour y mettre ses vivres, et résolut de manger, dormir et parler en n’importe quel lieu. Aussi disait-il, en montrant le portique de Zeus et le Pompéion, que les Athéniens les avaient construits à son intention, pour qu’il pût y vivre. Étant tombé malade, il s’appuyait sur un bâton. Par la suite, il le porta partout, à la ville et sur les routes, ainsi que sa besace . Il avait écrit à un ami de lui indiquer une petite maison ; comme l’ami tardait à lui répondre, il prit pour demeure un tonneau vide qu’il trouva au Métroon . Il le raconte lui-même dans ses lettres. L’été il se roulait dans le sable brûlant, l’hiver il embrassait les statues couvertes de neige, trouvant partout matière à s’endurcir.
Il était étrangement méprisant, nommait l’école d’Euclide école de bile, et l’enseignement de Platon perte de temps . Il appelait les concours en l’honneur de Dionysos de grands miracles de fous, et les orateurs les valets du peuple. Quand il regardait les pilotes, les médecins, et les philosophes, il pensait que l’homme était le plus intelligent de tous les animaux ; en revanche s’il regardait les interprètes des songes, les devins et leur cour, et tous les gens infatués de gloire et de richesse, alors il ne savait rien de plus fou que l’homme. Il répétait aussi sans cesse qu’il fallait aborder la vie avec un esprit sain ou se pendre.
Voyant un jour Platon, invité à un riche banquet, ne manger que des olives : « Comment, lui dit-il, toi Platon, l’homme sage qui es venu en Sicile en bateau, poussé par le désir de tables richement servies, quand elles sont là sous ton nez, tu n’en profites pas ? » Platon lui répondit : « Mais voyons, Diogène, c’est pour manger des olives et des mets semblables que je suis venu en Sicile. » Diogène alors de répliquer : « Quelle sottise de venir à Syracuse et de passer la mer, quand l’Attique produit elle aussi des olives ! » Ce discours est attribué à Aristippe par Phavorinos (Mélanges historiques). Un jour qu’il mangeait des figues sèches, Diogène rencontra encore Platon et lui dit : « Tu peux en prendre. » Platon en prit donc et les mangea, sur quoi Diogène lui fit observer : « Je t’ai dit d’en prendre, non d’en manger. » Un jour où Platon, au retour de chez Denys, avait invité des amis, Diogène, qui marchait sur les tapis, dit : « Je foule aux pieds l’orgueil de Platon. » Platon répliqua « Comme tu montres malgré toi ton orgueil, Diogène, toi qui prétends n’en pas avoir ! » D’autres auteurs veulent qu’à la phrase de Diogène, Platon ait répondu : « Avec ton propre orgueil, Diogène ! » Sotion (liv. IV) raconte en ces termes un entretien entre Platon et le philosophe cynique : Diogène avait demandé à Platon un peu de vin et des figues sèches. Platon lui donna une bouteille pleine, et Diogène lui dit : « Quand on te demande combien font deux et deux, réponds-tu vingt ? tu ne donnes pas ce que l’on te demande, et tu ne réponds pas à la question posée », et là-dessus il le traita de bavard.
On lui demandait en quel endroit de la Grèce il avait vu des hommes de bien : « Des hommes, dit-il, je n’en ai vu nulle part, mais j’ai vu des enfants à Lacédémone. » Un jour où il parlait sérieusement et n’était pas écouté, il se mit à gazouiller comme un oiseau, et il eut foule autour de lui. Il injuria alors les badauds, en leur disant qu’ils venaient vite écouter des sottises, mais que, pour les choses sérieuses, ils ne se pressaient guère. Il disait encore que les hommes se battaient pour secouer la poussière et frapper du pied, mais non pour devenir vertueux. Il s’étonnait de voir les grammairiens tant étudier les moeurs d’Ulysse, et négliger les leurs, de voir les musiciens si bien accorder leur lyre, et oublier d’accorder leur âme, de voir les mathématiciens étudier le soleil et la lune, et oublier ce qu’ils ont sous les pieds, de voir les orateurs pleins de zèle pour bien dire, mais jamais pressés de bien faire, de voir les avares blâmer l’argent, et pourtant l’aimer comme des fous. Il reprenait ceux qui louent les gens vertueux parce qu’ils méprisent les richesses, et qui dans le même temps envient les riches. Il était indigné de voir des hommes faire des sacrifices pour conserver la santé, et en même temps se gaver de nourriture pendant ces sacrifices, sans aucun souci de leur santé. Par contre, il admirait les esclaves de ne pas prendre de mets pour eux quand leurs maîtres étaient si goinfres. Il louait ceux qui devaient se marier et ne se mariaient point, ceux qui devaient aller sur mer, et n’y allaient point, ceux qui devaient gouverner et ne gouvernaient point, ceux qui devaient élever des enfants et n’en élevaient point, ceux qui se préparaient à fréquenter les puissants et ne les fréquentaient point. Il disait qu’il fallait tendre la main à ses amis, sans fermer les doigts.
Ménippe, dans son livre intitulé la Vertu de Diogène, raconte qu’il fut fait prisonnier et vendu, et qu’on lui demanda ce qu’il savait faire. Il répondit : « Commander », et cria au héraut : « Demande donc qui veut acheter un maître. » On lui défendit de s’asseoir : « Qu’importe, dit-il, on achète bien les poissons couchés sur le ventre ! » Une autre chose encore l’étonnait : « Quand nous achetons une marmite ou un vase, nous frappons dessus pour en connaître le son ; s’agit-il d’un homme, nous nous contentons de le regarder. » Il dit à Xéniade, qui venait de l’acheter, qu’il devrait lui obéir bien que Diogène fût son esclave, car s’il avait pour esclave un médecin ou un pilote, il lui obéirait. Eubule (Vente de Diogène) dit qu’il éleva très bien les enfants de Xéniade, et qu’après leur avoir appris toutes les sciences, il leur montra encore à monter à cheval, tendre l’arc, lancer la fronde et jeter le javelot. A la palestre, il interdisait au pédotribe de les exercer pour en faire des athlètes, il voulait simplement qu’ils prennent de la force et une bonne santé. Ces enfants apprirent aussi de nombreux passages des poètes, des prosateurs et même des écrits de Diogène, qui leur présentait pour chaque science des résumés et des abrégés pour les leur faire retenir plus aisément. A la maison, il leur apprenait à se servir eux-mêmes, à se contenter de mets très simples et à ne boire que de l’eau. Il leur faisait couper les cheveux ras, les forçait à ne mettre que des vêtements simples, les emmenait avec lui sans tunique ni souliers, leur imposait silence et les forçait à ne regarder en chemin que lui-même. Il les menait aussi à la chasse. De leur côté, ces enfants avaient grand soin de Diogène, et faisaient de lui des éloges à leurs parents. Le même auteur nous apprend qu’il resta chez Xéniade jusqu’à sa vieillesse, qu’il y mourut, et fut enterré par les enfants de son maître. Le jour où Xéniade lui demanda comment il voulait être enterré, il répondit : « sur le visage », et comme l’autre s’étonnait, il expliqua : « parce que bientôt ce qui est en bas sera en haut ». On croit qu’il faisait allusion aux Macédoniens, dont le pouvoir, d’abord faible, commençait à grandir.
Un jour, un homme le fit entrer dans une maison richement meublée, et lui dit : « Surtout ne crache pas par terre. » Diogène, qui avait envie de cracher, lui lança son crachat au visage, en lui criant que c’était le seul endroit sale qu’il eût trouvé et où il pût le faire. On attribue parfois le mot à Aristippe. Un jour, il cria : « Holà ! des hommes ! » On s’attroupa, mais il chassa tout le monde à coups de bâton, en disant : « J’ai demandé des hommes, pas des déchets ! ». On cite ce mot d’Alexandre : « Si je n’étais Alexandre, je voudrais être Diogène ! » Les hommes dans le besoin n’étaient pas, à l’en croire, les sourds et les aveugles, mais ceux qui n’avaient pas de besace. Il entra un jour, à demi rasé, dans un banquet de jeunes gens, et reçut des coups; il inscrivit alors sur un tableau blanc les noms de ceux qui l’avaient frappé, et se promena par les rues, en le tenant devant soi, tout nu, jusqu’à ce qu’il leur eût rendu leurs outrages, en les exposant aux reproches et aux coups de la foule. Il disait être un des chiens les plus loués, et pourtant aucun de ceux qui faisaient son éloge n’osait l’emmener à la chasse. Quelqu’un lui dit : « Je battrai des hommes aux jeux Pythiques », et Diogène répondit : « Non, les hommes, c’est moi qui les bats. » On lui disait : « Tu es vieux, repose-toi », mais il répondait : « Si je faisais la course de fond dans le stade, devrais-je ralentir près du but, ou plutôt foncer vers lui de toutes mes forces ? » Convié à un festin, il refusa d’y assister, sous prétexte que la veille on ne le lui avait pas offert. Il marchait nu-pieds sur la neige, et supportait toutes sortes d’épreuves comme je l’ai dit plus haut. Il essaya même de manger de la viande crue, mais ne persista pas dans cette tentative.
Il rencontra une fois l’orateur Démosthène, qui déjeunait dans une auberge, et comme celui-ci cherchait à se cacher, Diogène lui dit qu’en le faisant il s’enfonçait davantage dans l’auberge. Il le montra du doigt à des étrangers qui voulaient le voir, en disant : « Voilà le conducteur du peuple athénien. »
Un homme avait laissé tomber son pain et n’osait pas le ramasser. Diogène voulut lui donner une leçon. Il attacha une bouteille par le goulot, et la traîna derrière lui dans le quartier du Céramique. Il prétendait imiter les maîtres de musique qui chantent un ton plus haut pour que les choristes parviennent à donner le ton juste. Les hommes, disait-il, montrent leur folie par leur doigt : qui tend le médius passe pour un fou, qui tend l’index, au contraire. Il remarquait avec étonnement que les choses les plus précieuses se vendent le moins cher et inversement. Ainsi on paie trois mille drachmes pour une statue, et pour deux sous on a de la farine. Il conseilla à Xéniade, qui l’acheta, de lui obéir, et comme l’autre répondait :
Les fleuves alors remontent vers leur source ?
Diogène répliqua : « Si tu avais acheté un médecin et que tu fusses malade, tu lui obéirais sans dire que les fleuves remontent vers leur source ».
Quelqu’un voulait étudier la philosophie avec lui. Diogène l’invita à le suivre par les rues en traînant un hareng. L’homme eut honte, jeta le hareng et s’en alla, sur quoi Diogène, le rencontrant peu après, lui dit en riant : « Un hareng a rompu notre amitié. » Dioclès raconte la scène d’une autre façon : un homme dit à Diogène : « Prescris-moi quelque chose. », Le philosophe prit un morceau de fromage et le lui donna à porter. L’homme refusa, et Diogène lui dit : « Un morceau de fromage a rompu notre amitié. »
Voyant un jour un petit garçon qui buvait dans sa main, il prit l’écuelle qu’il avait dans sa besace, et la jeta en disant : « Je suis battu, cet enfant vit plus simplement que moi. » Il jeta de même une autre fois son assiette pour avoir vu de la même façon un jeune garçon qui avait cassé la sienne faire un trou dans son pain pour y mettre ses lentilles.
Il tenait des raisonnements comme celui-ci : « Tout appartient aux dieux, or les sages sont les amis des dieux et entre amis tout est commun, donc tout appartient aux sages. » Voyant un jour une femme prosternée devant les dieux et qui montrait ainsi son derrière, il voulut la débarrasser de sa superstition. Il s’approcha d’elle et lui dit: « Ne crains-tu pas, ô femme, que le dieu ne soit par hasard derrière toi (car tout est plein de sa présence) et que tu ne lui montres ainsi un spectacle très indécent ? » Il posta un gladiateur près de l’Asclépéion avec mission de bien battre tous ceux qui viendraient se prosterner bouche contre terre. Il avait coutume de dire que les imprécations des poètes tragiques étaient retombées sur lui puisqu’il était
Sans ville, sans maison, sans patrie,
Gueux, vagabond, vivant au jour le jour.
Il affirmait opposer à la fortune son assurance, à la loi sa nature, à la douleur sa raison. Dans le Cranéion, à une heure où il faisait soleil, Alexandre le rencontrant lui dit : « Demande-moi ce que tu veux, tu l’auras. » Il lui répondit : « Ote-toi de mon soleil ! » Un homme qui faisait une longue lecture, parvenu enfin au bout de son rouleau, montrait qu’il n’y avait plus rien d’écrit sur la page. « Courage, dit Diogène, je vois la terre. » Un autre lui démontrait par syllogisme qu’il avait des cornes, il se toucha le front et dit : « Je n’en vois pas. » Un autre jour où quelqu’un niait le mouvement, il se leva et se mit à marcher. Un philosophe parlait des choses célestes. « Depuis quand es-tu donc arrivé du ciel ? » lui demanda Diogène. Un méchant eunuque écrivait sur sa maison : « Qu’aucun méchant n’entre ici ! » « Mais, demanda Diogène, le maître de la maison, par où entrera-t-il ? » Il se frottait les pieds de parfum, disant que le parfum qu’on se met sur la tête monte au ciel ; si l’on veut qu’il vous vienne au nez, il faut donc se le mettre aux pieds. Les Athéniens voulurent l’initier aux mystères, et lui assuraient que les initiés avaient aux enfers les places d’honneur. Il leur dit : « Ce serait une plaisante chose qu’Agésilas et Épaminondas fussent là-bas dans le bourbier, et que le premier venu, s’il est initié, fût dans les îles des bienheureux! »
Comme des souris couraient sur sa table, il dit : « Diogène lui aussi nourrit des parasites. » Platon l’appela chien. « Le nom me va bien, dit-il, car je suis revenu à ceux qui m’ont vendu. » Un jour où il sortait du bain, quelqu’un lui demanda s’il y avait vu beaucoup d’hommes ; il répondit : non, mais à un autre qui lui demandait s’il y avait foule, il répondit oui. Platon ayant défini l’homme un animal à deux pieds sans plumes, et l’auditoire l’ayant approuvé, Diogène apporta dans son école un coq plumé, et dit : « Voilà l’homme selon Platon. » Aussi Platon ajouta-t-il à sa définition : « et qui a des ongles plats et larges ».
On lui demanda un jour à quelle heure il fallait manger : « Quand on est riche, répondit-il, on mange quand on veut, quand on est pauvre on mange quand on peut. » Voyant à Mégare des moutons portant toute leur laine et des enfants allant tout nus, il s’écria : « Il vaut mieux à Mégare être un bélier qu’un enfant. » Un jour un passant lui cria « Gare ! », mais quand il l’avait déjà heurté d’une poutre qu’il portait, et Diogène de lui dire : « Tu veux donc m’en donner un second coup ? » Les orateurs lui paraissaient les valets du peuple, et les couronnes des boutons donnés par cette fièvre : la gloire. Il se promenait en plein jour avec une lanterne et répétait : « Je cherche un homme. » Il était un jour trempé jusqu’aux os par la pluie, et comme on le prenait en pitié, Platon intervint et dit aux badauds : « Si vous avez vraiment pitié de lui, allez-vous-en » ; il soulignait par là l’orgueil de Diogène. Une autre fois, il reçut un coup de poing. « Par Hercule, s’écria-t-il, je ne me serais jamais douté qu’il me fallût avoir toujours la tête protégée d’un casque ! » Midias le roua de coups et lui cria : « Il y a trois mille drachmes pour toi chez mon banquier. » Diogène prit le lendemain un gantelet de pugiliste, lui rendit ses coups, et lui dit : « Tu as toi aussi tes trois mille drachmes chez mon banquier.» Lysias l’apothicaire lui demandait s’il croyait à l’existence des dieux. « Comment n’y croirais-je pas, dit-il, quand je te vois, toi le plus grand ennemi des dieux ?» On attribue parfois le mot à Théodore. Il vit une fois un homme qui se purifiait à grande eau, et il lui dit : « Malheureux, toute cette eau ne réussirait même pas à laver tes fautes de grammaire, et tu t’imagines pouvoir laver toutes les fautes que tu as commises pendant ta vie ! » Il reprochait aux hommes leurs prières, parce qu’ils demandaient des biens apparents et non des biens réels. A ceux que les songes effrayaient, il disait : « Vous ne vous souciez pas de ce que vous voyez pendant la veille, pourquoi vous inquiéter des choses imaginaires qui vous apparaissent dans le sommeil ? » Aux jeux olympiques, le héraut ayant proclamé : « Dioxippe a vaincu les hommes », Diogène répondit : « Il n’a vaincu que des esclaves ; les hommes, c’est mon affaire. »
Les Athéniens l’aimaient beaucoup. Ils fessèrent un jeune homme qui avait brisé son tonneau, et remplacèrent le tonneau. Denys le stoïcien raconte que, fait prisonnier à Chéronée, il fut conduit auprès de Philippe. Le roi lui demanda qui il était et Diogène répondit : « Je suis l’espion de ton avidité. » Philippe en fut tout éberlué et lui rendit la liberté. Alexandre ayant envoyé une lettre à Antipatros, à Athènes, par l’intermédiaire d’un messager qui s’appelait Piteux, Diogène, qui se trouvait là à son arrivée, dit :
Piteux, tu viens piteusement à un piteux de la part d’un piteux.
Perdicax le menaça de le faire mourir s’il ne se décidait pas à venir le voir. Il répondit : « Ce n’est pas fort ; un scarabée, une tarentule en feraient autant. Que ne m’as-tu fait cette menace : même sans toi, je puis vivre heureux ! » Il criait souvent et à tous les échos que les dieux ont donné à l’homme une vie facile, mais qu’elle ne consiste pas à rechercher les boissons fines, les parfums, et les autres jouissances de ce genre. Aussi, voyant un jour un homme qui se faisait chausser par son esclave, lui dit-il : « Tu n’es pas encore heureux, si tu ne te fais pas moucher aussi ; cela viendra, quand tu seras devenu manchot. » Ayant vu un autre jour des gardiens des archives sacrées emmener en prison un homme qui avait volé une coupe au trésor, il dit : « Voilà de grands voleurs qui en emmènent un petit. »
La vue d’un enfant qui jetait des pierres contre un gibet lui fit dire : « Courage, tu finiras par atteindre le but ! » Des jeunes gens qui l’entouraient disaient : « Prenons garde qu’il ne nous morde ! » — « Ne craignez rien, garçons, leur dit-il, un chien ne mange pas de bettes. » Quelqu’un se glorifiait d’avoir sur le dos une peau de lion. « Cesse donc, lui dit-il, de déshonorer la couverture de la vertu. » Quelqu’un trouvait Callisthène heureux d’être reçu par Alexandre avec munificence. « Non, dit Diogène, il faut le plaindre, car il ne déjeune et ne dîne que quand il plaît à Alexandre. » Quand il avait besoin d’argent et qu’il s’adressait à ses amis, il ne leur demandait pas de lui en donner, mais de lui en rendre.
Un jour où il se masturbait sur la place publique, il s’écria : « Plût au ciel qu’il suffît aussi de se frotter le ventre pour ne plus avoir faim ! » Voyant un jeune homme qui s’en allait déjeuner avec des satrapes, il l’en empêcha, le tira à part, le ramena chez ses parents et leur conseilla de le surveiller. A un autre garçon qui s’était fardé et qui lui posait une question, il déclara qu’il lui répondrait seulement quand il se serait mis tout nu, et qu’il pourrait voir si son interlocuteur était un homme ou une femme. Il dit à un autre qui au bain jouait au cottabe : « Mieux tu feras, pis ce sera. » Pendant un repas, on lui jeta des os comme à un chien ; alors, s’approchant des convives, il leur pissa dessus comme un chien. Aux orateurs et à tous ceux qui avaient quelque réputation d’éloquence, il donnait le nom de trois fois hommes, c’est-à-dire de trois fois malheureux. Un riche ignorant était pour lui un mouton à toison d’or. Voyant sur la maison d’un libertin l’écriteau : « A vendre », « Je savais bien, dit-il, que tu étais à vendre, et tu vomirais facilement ton maître, ô maison, tant tu as l’estomac lourd d’ivrognerie. » Un garçon se plaignait à lui de recevoir des propositions de trop de gens, il lui dit : « Tais-toi donc, et ne montre pas partout les indices de tes désirs impurs. » Étant entré dans un bain malpropre, il demanda : « Ceux qui se sont baignés ici, où se lavent-ils ? »
Il louait un fort gaillard, joueur de cithare, dont tout le monde se gaussait, et comme on lui en demandait la raison, il la donna : « C’est parce que, fort comme il est, il joue de la cithare, et ne songe pas à faire le brigand. » Un autre faisait toujours fuir son auditoire, et Diogène quand il le rencontrait lui disait : « Bonjour, coq. » L’autre lui demanda pourquoi il l’appelait ainsi. « C’est que ton chant éveille tout le monde ! » Un jour où un jeune garçon s’exhibait devant la foule, il vint se mettre en face de lui, après avoir rempli sa tunique de fèves, et il se mit à les manger. La foule laissa le jeune homme et fit cercle autour de Diogène, qui s’étonna alors de la voir abandonner l’homme qui s’exhibait. Un homme superstitieux lui dit une fois « Je te casserais la tête d’un seul coup. » « Et moi, lui dit Diogène, il me suffira d’éternuer à gauche pour te faire trembler. » Hégésias lui demanda de lui donner un de ses livres. Diogène lui dit : «Tu es fou, Hégésias, toi qui prends les vraies figues et non pas les figues peintes, de laisser l’exercice vivant pour l’exercice écrit ! » On lui reprochait son exil. « C’est grâce à lui, dit Diogène, que je suis devenu philosophe. » Et comme un autre à son tour lui disait : « Les gens de Sinope t’ont chassé de chez eux », il répondit : « Moi, je les condamne à rester chez eux. » Il vit un jour un berger vainqueur aux jeux olympiques. « Mon brave, lui dit-il, tu vas maintenant quitter les jeux olympiques pour les jeux néméens. » On lui demandait pourquoi les athlètes sont insensibles : « Parce qu’ils sont gavés de viande de boeuf et de cochon. » Il demanda un jour qu’on lui élevât une statue, et quand on lui demanda pourquoi il avait fait une telle demande, il répondit que c’était pour avoir le plaisir de se la voir refuser. Tombé un jour dans le dénuement, il demanda l’aumône pour la première fois, et il dit : « Si tu donnes aux autres, donne-moi aussi, et si tu ne donnes pas aux autres, commence par moi. » Un tyran lui demandait quel était le meilleur bronze pour faire une statue ; il répondit que c’était celui dans lequel on avait fondu la statue d’Harmodios et d’Aristogiton, les tyrannicides. On lui demandait comment Denys traitait ses amis : « Il en use, dit-il, comme il use des bouteilles, quand elles sont pleines, il les caresse ; quand elles sont vides, il les jette. » Un jeune marié avait écrit sur sa porte :
Le fils de Zeus, Hercule aux belles victoires,
Vit céans, qu’il n’y entre aucun mal.
Diogène ajouta : « Après la guerre vient l’alliance. »
Il prétendait que l’amour de l’argent était la citadelle de tous les maux. Voyant un libertin manger des olives dans une auberge, il lui dit : « Si tu n’avais mangé que des olives à ton déjeuner, ce dîner ne te suffirait pas ! »
Selon lui les gens de bien étaient des images des dieux et l’amour une occupation d’oisifs. On lui demandait ce qui était pénible dans la vie : « Vieillir sans ressources » ; quelle bête avait la morsure la plus terrible « Chez les bêtes sauvages c’est le sycophante, chez les animaux domestiques c’est le flatteur. » Voyant deux centaures mal peints, il demanda lequel des deux était le Pire. Un discours flatteur était pour lui un lacet enduit de miel. Il appelait le ventre la Charybde de la vie. Il entendit dire un jour que le joueur de flûte Testicule avait été convaincu d’adultère. « Il mérite d’être pendu par son nom », dit-il. On lui demandait pourquoi l’or était pâle : « C’est parce que beaucoup de gens lui en veulent », répondit-il. Voyant passer une femme en litière, il s’écria : « Ce n’est pas là la cage qu’il faut à cette bête. » Un esclave fugitif était assis sur la margelle d’un puits : « Jeune homme, lui dit-il, prends garde d’y tomber! » Voyant au bain un enfant qui avait volé un vêtement, il lui demanda s’il était venu pour se faire frotter ou pour voler un autre manteau. Voyant des femmes pendues à des oliviers, il fit cette remarque : « Plût au ciel que tous les arbres eussent de tels fruits ! » Il dit à un détrousseur d’habits :
Que cherches-tu, mon brave, voudrais-tu dépouiller les morts ?
On lui demandait s’il avait valet et servante, il répondit non. « Mais si tu meurs, lui dit-on, qui t’enterrera ? » — « Celui qui aura envie de ma maison » dit-il. Passant auprès d’un beau garçon qui dormait sans prendre garde, il lui dit :
Éveille-toi,
Pour ne pas recevoir, pendant ton sommeil, un coup de lance dans [le derrière !
Il dit à un autre qui préparait un riche dîner : « Tu mourras jeune, mon fils, si tu achètes tant de choses. » Platon, parlant des idées, nommait l’idée de table et l’idée de tasse. « Pour moi, Platon, dit Diogène, je vois bien la tasse et la table, mais je ne vois pas du tout l’idée de table ni l’idée de tasse. » « Bien sûr, répliqua Platon, car pour voir la table et la tasse tu as les yeux, mais pour voir les idées qui leur correspondent, il te faudrait plus d’esprit que tu n’en as. » (Quand on demandait à Platon ce qu’il pensait de Diogène, il répondait : « C’est un Socrate devenu fou. ») On demandait à Diogène à quel âge il faut prendre femme, il répondait : « Quand on est jeune, il est trop tôt, quand on est vieux il est trop tard. » On lui demandait encore : « Que faire, quand on a reçu une gifle ? » Prendre un casque », disait-il. Il dit à un jeune garçon qui s’était fardé : « Si c’est pour aller voir des hommes, tu es un pauvre homme, si c’est pour aller voir des femmes, tu es un infâme. » Il dit à un jeune homme qui rougissait : « Bravo, c’est la couleur de la vertu. » Ayant entendu discuter deux plaideurs, il les condamna tous les deux, l’un pour avoir volé ce que l’autre réclamait, l’autre pour réclamer quelque chose qu’on ne lui avait pas volé. On lui demandait un jour quel était son vin préféré, il répondit : « Celui des autres. » Un autre lui dit : « Tout le monde se moque de toi. » « Cela ne me touche pas, » dit-il.
Quelqu’un lui disait : « Vivre est un mal. » « Non, dit-il, mais mal vivre. » On lui conseillait de rechercher son esclave qui s’était enfui. « Ce serait une plaisante chose, dit-il, que Manès pût vivre sans Diogène, et que Diogène ne pût pas vivre sans Manès. » Un jour où il mangeait des olives, on lui offrit des gâteaux, il les jeta en disant :
O mon hôte, chasse de ma route les tyrans
et encore :
Il le fouetta pour le faire courir.
On lui demandait quelle sorte de chien il était. « Quand j’ai faim, je suis un pauvre roquet de Mélita ; quand j’ai mangé, je suis un gros Molosse, et que l’on n’ose pas emmener avec soi à la chasse, tant on a de peine à le tenir. » Il ajoutait : « Ainsi, vous ne pouvez pas vivre avec moi, car vous craignez les coups de dents. » On lui demandait si les sages mangeaient du gâteau. « Ils mangent de tout comme le reste des hommes », dit-il. On lui demandait encore pourquoi on donnait aux mendiants et non aux philosophes, il répondit : « Parce qu’on estime qu’on pourra devenir soi-même boiteux ou aveugle, mais on sait bien qu’on ne deviendra jamais philosophe. » Il dit à un avare à qui il demandait l’aumône, et qui tardait à le satisfaire : « Donne-moi de la nourriture et non pas une sépulture. »
A qui lui reprochait un jour d’avoir fait de la fausse monnaie, il dit : « Il fut en effet un temps où je vous ressemblais, mais vous ne serez jamais ce que je suis maintenant. » A un autre qui lui faisait le même reproche, il répondit : « Il fut un temps où j’étais prompt à convoiter, ce temps n’est plus. » Il alla un jour à Myndes et s’étonna de voir une si petite ville fermée par de si grandes portes, et il dit : « Gens de Myndes, fermez bien les portes, que votre ville ne se sauve pas ! » Il vit prendre sur le fait un voleur qui venait de dérober une étoffe pourpre, et récita :
Il a succombé à un destin pourpre et à une dure Destinée.
Cratère l’avait invité à venir le voir. « Je préfère, lui dit-il, lécher du sel à Athènes, à venir m’asseoir à l’opulente table de Cratère. ». Rencontrant l’orateur Anaximène, qui était obèse, il lui dit : « Donne-moi ton ventre, tu seras allégé d’autant, et tu me rendras service, car je suis gueux. » Une fois où cet orateur faisait un discours, il sortit un hareng saur et attira à lui tout l’auditoire, et comme l’orateur s’indignait, « Voilà qu’un hareng saur d’un sou a coupé les effets d’Anaximène », dit Diogène. On lui reprochait un jour d’avoir mangé en pleine place. « N’ai-je pas eu faim sur la place ? » répliqua-t-il.
On lui attribue parfois aussi le mot que j’ai cité plus haut et que voici. Platon, qui le vit laver de la salade, s’approcha et lui dit doucement : « Si tu avais été aimable pour Denys, tu ne laverais pas de la salade », sur quoi Diogène lui répondit sur le même ton « Et toi, si tu avais lavé ta salade, tu n’aurais pas été l’esclave de Deny. »
Quelqu’un lui disait : « Tout le monde se moque de toi. » Il répondit : « Et peut-être aussi les ânes se moquent-ils de ces gens-là, mais ils ne font pas attention aux ânes, et moi je ne fais pas attention à eux. » Ayant entendu un beau garçon s’entretenir de philosophie, il le loua de vouloir transformer en amants de son esprit les amants de son corps. Quelqu’un s’étonnait de voir tant d’ex-voto à Samothrace. « Il y en aurait bien davantage, dit Diogène, si ceux qui n’ont pas été exaucés en avaient aussi consacré. » Cette réponse est quelquefois attribuée à Diogoras de Mélos. Il dit à un jeune garçon qui s’en allait à un festin : « Tu en reviendras Pire », et comme le lendemain l’autre lui disait : « Me voilà et je n’en suis pas pire », il lui répondit : « Tu n’es pas Pire, mais tu es Plus large. »
Il demandait l’aumône à un homme morose, qui lui dit : « Je te donnerai si tu me persuades », à quoi Diogène répondit : « Si je pouvais le faire, je te persuaderais plutôt d’aller te pendre. »
Au retour à Athènes d’un voyage à Sparte, on lui demanda où il allait et d’où il venait, il répondit : « Je reviens de chez des hommes, et j’arrive chez des femme. » A son retour des jeux olympiques, on lui demanda s’il y avait foule : « Oui, dit-il, mais les hommes étaient rares».
Il disait des débauchés qu’ils étaient semblables aux figuiers qui poussent au bord des précipices, l’homme ne peut en goûter le fruit, ils sont mangés par les corbeaux et les vautours. La courtisane Phryné avait consacré une statue d’or à Aphrodite, Diogène y mit cette inscription : « En souvenir de l’incontinence des Grecs. » Alexandre le rencontrant un jour lui dit : « Je suis le grand roi Alexandre. » Diogène alors se présenta : « Et moi je suis Diogène, le chien. » On lui demanda pourquoi il était appelé chien : « Parce que je caresse ceux qui me donnent, j’aboie contre ceux qui ne me donnent pas, et je mors ceux qui sont méchants. » Il cueillait des fruits à un figuier, le gardien lui dit : « Hier, on y a pendu un homme. » « Je le purifie donc », dit Diogène.
Un vainqueur olympique n’avait d’yeux que pour une courtisane. « Voyez donc ce bélier d’Arès, dit Diogène, mené en laisse par la première catin venue. » Il comparait les belles filles de joie à de l’hydromel empoisonné. Quand il mangeait sur la place publique, les passants le traitaient toujours de chien. « Vous êtes les chiens, répondait-il, puisque vous faites cercle autour de moi pendant que je mange. » Comme deux débauchés s’enfuyaient à son approche : « N’ayez pas peur, leur cria-t-il, le chien ne mange pas de bettes. » On lui demandait de quel pays était un jeune garçon dont on avait abusé : « Il est de Tégée », dit-il. Voyant un lutteur peu courageux qui faisait de la médecine, il lui demanda s’il cherchait les moyens de faire mourir ceux qui l’avaient vaincu. Voyant le fils d’une catin jeter des pierres à la foule : « Fais attention, lui dit-il, tu pourrais blesser ton père. » Un jeune garçon lui montrait une épée que son amant lui avait donnée : « L’épée est belle, dit-il, mais la garde est laide».
On louait un homme qui avait fait un présent à Diogène : « Et moi qui ai mérité de le recevoir, vous ne me louez pas ? » Un homme lui réclamait son manteau : « Si tu me l’as donné, dit-il, il est à moi et si tu me l’as prêté, je m’en sers. » On le soupçonnait de cacher de l’or sous son manteau : « C’est bien pourquoi je le mets sous moi pour dormir », répondit Diogène. On lui demandait quel profit il avait retiré de la philosophie, il répondit : « A tout le moins, celui d’être capable de supporter tous les malheurs. » Quand on lui demandait sa patrie, il disait : « Je suis citoyen du monde. » Il vit des gens faire un sacrifice pour avoir un enfant, et il s’étonna de ne pas les voir faire de sacrifice pour savoir de quelle nature serait leur enfant. Invité à un banquet, il dit au président du festin qui lui demandait son écot :
Dépouille les autres, mais éloigne tes mains d’Hector.
Il déclarait que les courtisanes étaient les reines des rois, puisque les rois obéissaient à leurs moindres désirs. Les Athéniens ayant par décret nommé Alexandre Dionysos, il demanda à être nommé Sérapis. Quand on lui reprochait de fréquenter les maisons closes, il disait : « Le soleil va bien dans les latrines, et pourtant il ne s’y souille pas ! » Déjeunant dans un temple, il vit sur la table des pains de mauvaise qualité. Il les jeta en disant que dans un temple, il ne devait rien y avoir de mauvaise qualité.
Quelqu’un lui dit : « Tu ne sais rien, et tu fais le philosophe. » « Mais, dit-il, simuler la sagesse, c’est encore être philosophe. » Un homme lui amena un jour son enfant, et le présenta comme très intelligent et d’excellentes moeurs. « Il n’a donc pas besoin de moi, répondit-il. » Il comparait les gens qui parlent du bien mais ne le font pas aux cithares qui n’entendent pas et sont insensibles. Il entrait au théâtre par la porte de sortie, et comme on s’en étonnait, il déclarait : « Je m’efforce de faire dans ma vie le contraire de tout le monde. » Il dit à un jeune homme efféminé : « N’as-tu pas honte de vouloir devenir pire que la nature ne t’a fait : elle a fait de toi un homme, et tu t’efforces de devenir une femme. » Un sot essayait d’accorder un instrument, il lui dit : « N’as-tu pas honte d’accorder des cordes sur un morceau de bois et d’oublier de mettre ton âme en accord avec ta vie ? » Quelqu’un lui dit : « Je ne suis pas fait pour la philosophie ». Diogène lui répondit : « Pourquoi vis-tu, si tu ne cherches pas à bien vivre ? » Il dit encore à un jeune homme qui méprisait son père : « N’as-tu pas honte de mépriser celui grâce à qui tu as le pouvoir de mépriser ? » Voyant un beau garçon qui bavardait à tort et à travers, il lui dit : « N’as-tu pas honte de tirer d’une gaine d’ivoire un glaive de plomb ? » On lui reprocha un jour d’aller boire au cabaret : « Je vais bien chez le barbier pour me faire tondre », dit-il. On lui faisait reproche d’avoir accepté un manteau d’Antipatros, il répondit par ce vers :
Quand un dieu nous fait un présent, prenons-le.
Un homme l’avait heurté d’une poutre et lui criait seulement après : « Gare ! » Diogène lui donna un coup de bâton, et cria : « Gare! » Voyant un homme serrer de près une courtisane : « Pourquoi veux-tu obtenir, malheureux, dit-il, ce qu’il vaut mieux ne pas avoir ? » A un homme parfumé il dit : « Prends garde que la bonne odeur de ta tête ne fasse ressortir la mauvaise odeur de ta vie. » Il disait que les serviteurs étaient esclaves de leurs maîtres, et les gens sans valeur de leurs passions. On lui demandait d’où venait le nom d’Andrapode donné aux esclaves. Il répondit : « De ce qu’ils ont des pieds d’homme, et l’esprit semblable au tien, qui m’interroges. » Il demandait une mine à un prodigue, et comme celui-ci voulait savoir pourquoi il lui demandait tant, quand il ne demandait aux autres qu’une obole : « C’est, dit-il, que j’espère bien que les autres me donneront plusieurs fois, tandis que pour toi, les dieux seuls savent si je pourrai encore recevoir de l’argent de toi. » On lui reprochait de mendier, quand Platon ne mendiait pas. « Mais il le fait aussi, dit-il, seulement,
C’est à l’oreille, pour que les autres ne l’entendent pas. »
Voyant un archer malhabile, il s’assit tout à côté du but, afin, dit-il, d’être sûr de ne rien recevoir. Il disait que les amoureux n’atteignent jamais le bonheur. On lui demandait si la mort était un mal : « Comment peut-elle être un mal, dit-il, puisque nous ne la sentons pas quand elle est arrivée» Alexandre lui demanda s’il le craignait : « Es-tu bon ou méchant ? » dit-il. « Je suis bon, dit l’autre. » — « Qui donc, dit alors Diogène, craindra un homme bon ? » Il conseillait d’enseigner aux enfants la sobriété, aux vieillards la résignation, aux pauvres la richesse, aux riches le luxe. Le débauché Testicule soignait l’oeil de sa pupille. « Prends garde, lui dit-il, en voulant soigner l’oeil, de ne corrompre la pupille. » Quelqu’un se plaignait que ses amis lui voulussent du mal. « Où allons-nous, dit-il, s’il faut se méfier de ses amis comme de ses ennemis ! » On lui demandait ce qu’il y avait de plus beau au monde : « La franchise », dit-il. Entré dans une école où il voyait beaucoup de Muses et peu de disciples : « En comptant les dieux, dit-il au maître, tu as beaucoup d’élèves. » Il avait coutume de tout faire en public, les repas et l’amour, et il raisonnait ainsi : « S’il n’y a pas de mal à manger, il n’y en a pas non plus à manger en public ; or il n’y a pas de mal à manger, donc il n’y a pas de mal à manger en public. » De même il se masturbait toujours en public, en disant « Plût au ciel qu’il suffît également de se frotter le ventre pour apaiser sa faim. » On rapporte bien d’autres choses sur lui, qu’il serait trop long de raconter en détail.
Il y avait selon lui deux sortes d’exercices, ceux de l’âme et ceux du corps. Le propre des exercices physiques étant de donner des spectacles susceptibles d’acheminer plus sûrement vers la vertu : chacune des deux sortes étant sans l’autre impuissante, la bonne santé et la force n’étant pas moins utiles que le reste, puisque ce qui concerne le corps concerne l’âme aussi. Il produisait des arguments pour montrer de quelle utilité sont pour l’acquisition de la vertu les exercices du corps. « Ne voyait-on pas, disait-il, dans les arts mécaniques et autres, les artisans obtenir par l’exercice l’habileté qui leur manquait, et les joueurs de flûte et les athlètes faire d’autant plus de progrès qu’ils s’exerçaient davantage, chacun dans leur métier, et que si ces gens font participer leur esprit à cet exercice, ce n’est ni inutilement, ni sans résultat qu’ils se sont donné de la peine ? » Il concluait donc qu’on ne peut rien faire de bien dans la vie sans exercice, et que l’exercice permet aux hommes de se surpasser. Quand il songeait qu’en laissant de côté toutes les peines futiles que nous nous donnons, et en nous exerçant conformément à la nature, nous pourrions et devrions vivre heureux, il regrettait de voir l’homme si malheureux par sa folie. Le mépris même du plaisir nous donnerait, si nous nous y exercions, beaucoup de satisfaction. Si ceux qui ont pris l’habitude de vivre dans les plaisirs souffrent quand il leur faut changer de vie, ceux qui se sont exercés à supporter les choses pénibles méprisent sans peine les plaisirs.
Il ne se contentait pas de parler de la sorte, il payait d’exemple, transformant les moeurs comme les monnaies, et sacrifia les lois à la nature. Il prétendait vivre comme Hercule et mettait la liberté au-dessus de tout, disait que tout appartenait aux sages, et appuyait ses opinions sur des raisonnements semblables à ceux que j’ai exposés plus haut : « Tout appartient aux dieux ; les dieux sont les amis des sages, tout est commun entre amis, donc tout appartient aux sages. » Il parlait encore de la loi, disant qu’on ne peut gouverner sans elle. « Sans cité organisée, la ville ne sert à rien ; donc la ville doit être une cité. Sans la cité, la loi ne sert à rien : donc la loi doit être liée à la cité. » Il se moquait de la noblesse et de la gloire, simples voiles de la perversité. La seule vraie constitution est celle qui régit l’univers.
Il voulait la communauté des femmes ; niait la valeur du mariage, préconisait l’union libre au gré de chacun et selon les penchants de chacun. Pour cette raison, il voulait aussi la communauté des enfants.
Il ne voyait pas qu’il fût mal d’emporter les objets d’un temple, ou de manger la chair de n’importe quel animal, et ne trouva pas si odieux le fait de manger de la chair humaine, comme le, font des peuples étrangers, disant qu’en saine raison, tout est dans tout et partout.
Il y a de la chair dans le pain et du pain dans les herbes ; ces corps et tant d’autres entrent dans tous les corps par des conduits cachés, et s’évaporent ensemble, comme il le montre dans sa pièce intitulée Thyeste, si toutefois les tragédies qu’on lui attribue sont de lui, et non pas de son ami Philiscos d’Égine ou de Pasiphon, fils de Lucien, dont Phavorinos (Mélanges historiques) nous dit qu’il les écrivit après la mort de Diogène. Diogène méprisait encore la musique, la géométrie, l’astrologie et les autres sciences de ce genre, et il déclarait qu’elles n’étaient ni nécessaires ni utiles.
Il avait l’art de trouver la réponse décisive aux objections, comme on peut le voir par les anecdotes que j’ai citées. Il supporta dignement ses épreuves quand on le vendit comme esclave. Naviguant un jour vers Égine, et pris par des pirates dont le chef était Scirpalos, il fut en effet conduit en Crète et vendu sur le marché. Quand le héraut lui demanda ce qu’il savait faire, il répondit : « Commander. » Puis, montrant du doigt un Corinthien richement vêtu, ce Xéniade dont j’ai parlé, il dit : « Vends-moi à cet homme, je vois qu’il a besoin d’un maître. » Xéniade l’acheta, le ramena à Corinthe, lui confia l’éducation de ses enfants, et le nomma intendant de sa maison, et Diogène mit de l’ordre partout, si bien que Xéniade s’en allait répétant : « Il est entré un bon génie dans ma maison. »
Cléomène, dans son livre intitulé De l’Educateur, raconte que ses amis voulurent le racheter, mais Diogène les traita de sots et leur dit : « Les lions ne sont pas esclaves de ceux qui les nourrissent, ce sont ceux-ci leurs esclaves ; un esclave a peur, la bête sauvage fait peur ! »
Très persuasif, il s’attachait sans peine les gens par ses discours. En voici une preuve : un certain Onésicrite d’Égine avait deux fils. Il en envoya un, Androsthène, à la ville d’Athènes. Ce jeune homme alla écouter Diogène, et ne le quitta plus. Onésicrite envoya alors le second fils, Philiscos, que j’ai déjà nommé, et qui était l’aîné, pour chercher et ramener à Égine le cadet. Mais il fut séduit par Diogène tout comme son frère et ne revint pas. Onésicrite vint alors lui-même ; mais il fit comme ses fils et resta avec eux pour philosopher auprès de Diogène. Notre philosophe eut encore pour disciples Phocion, surnommé le Bon, et Stilpon de Mégare, et beaucoup d’autres hommes politiques.
On rapporte qu’il mourut à près de quatre-vingt-dix ans, mais tout le monde n’est pas d’accord sur la façon dont il mourut. Les uns veulent que pour avoir mangé tout cru un poulpe il soit mort du choléra, les autres, et parmi eux Kercide de Mégalopolis, qu’il se soit volontairement asphyxié en retenant sa respiration. Ce dernier auteur le dit en vers :
Il n’est plus, l’homme de Sinope,
L’homme au bâton, au double manteau, qui mangeait en plein air ;
Il est monté au ciel pour avoir de ses dents
Mordu ses lèvres et retenu son souffle. C’était,
Ce Diogène, un vrai fils de Zeus et un chien céleste.
D’autres auteurs racontent encore que, voulant arracher aux chiens un morceau de poulpe, il fut mordu au pied et en mourut. Les amis de Diogène toutefois croient à la tradition de la respiration retenue. Car il vivait au Cranion, gymnase situé aux portes de Corinthe, et quand, à leur habitude, ses amis vinrent le voir, ils le trouvèrent enveloppé dans son manteau. Ils crurent d’abord qu’il dormait, puis, le sachant peu enclin au sommeil, ils soulevèrent le manteau et trouvèrent le philosophe inanimé et sans souffle. Ils pensèrent qu’il l’avait retenu volontairement par désir de la mort. Alors ils se disputèrent pour savoir qui l’enterrerait, et peu s’en fallut qu’ils n’en vinssent aux coups. La discorde fut apaisée par l’arrivée de leurs parents et des gens influents de la ville, qui firent enterrer Diogène près de la porte qui conduit à l’Isthme. Ils dressèrent sur sa tombe une colonne, surmontée d’un chien de marbre de Paros. Plus tard ses compatriotes lui érigèrent une statue de bronze avec cette inscription :
Le temps ronge le bronze, mais
Ta gloire, Diogène, sera éternelle,
Car seul tu as montré aux hommes à se suffire à eux-mêmes,
Et tu as indiqué le plus court chemin du bonheur.
J’ai, pour ma part, écrit ces vers procéleusmatiques :
Dis-moi, Diogène, quelle mort t’a conduit
Aux Enfers ? ce fut la sauvage morsure d’un chien.
Quelques auteurs veulent qu’il ait demandé qu’on laissât son corps sans sépulture, pour que les chiens pussent y prendre leur morceau, et qu’au moins, si on tenait à le mettre en fosse, on le recouvrît seulement d’un peu de poussière. D’autres disent qu’il voulait être jeté dans l’Ilissos, pour être utile à ses frères. Démétrios (Homonymes) dit que Diogène mourut à Corinthe, le jour où Alexandre mourait à Babylone. Il était déjà un vieillard pendant la cent treizième olympiade.
On lui attribue les ouvrages suivants : des dialogues, parmi lesquels : Céphalion, Ichtas, le Geai, Pordalos, le Peuple d’Athènes, la Constitution, Traité de morale, de la Richesse, Art d’aimer, Théodore, Hypsias, Aristarque, de la Mort ; des Lettres ; et sept tragédies : Hélène, Thyeste, Héraclès, Achille, Médée, Chrysippe, Œdipe. Sosicrate (Successions, liv. I) et Satyros (Vies, liv. IV) disent qu’aucun de ces ouvrages n’est de Diogène. Les tragédies, selon Satyros, sont de Philiscos d’Égine. Sotion (liv. VII) affirme que seuls sont de Diogène les livres sur la Vertu, sur le Bien, sur l’Art d’aimer, sur la Mendicité, sur l’Audace, le Pordalos, Cassandre, Céphalion, Philiscon, Aristarque, Sisyphe, Ganymède, de l’Usage et les Lettres.
Il y eut cinq Diogène : un physicien d’Apollonie, qui écrivit un livre commençant ainsi : « Quiconque entreprend un ouvrage doit, ce me semble, commencer par poser des principes indiscutables », un historien de Sicyone auteur d’un livre sur le Péloponnèse, notre philosophe, un Stoïcien de la race de Séleucos, et qui fut appelé le Babylonien, parce qu’il était né près de ce pays, un écrivain de Tarse qui s’est efforcé de résoudre des problèmes poétiques. De ce dernier Athénodore dit (Promenades, liv. VIII) qu’il était philosophe et paraissait toujours luisant parce qu’il se frottait d’huile.