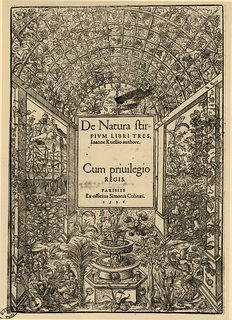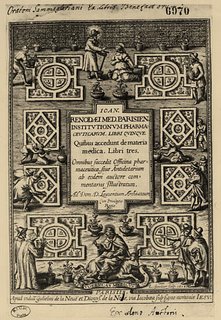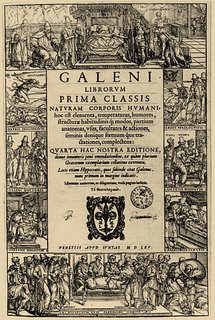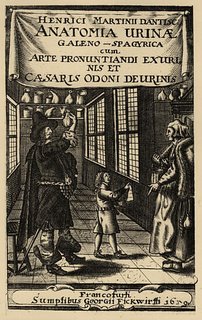L'Apothèose d'Homère, Jean-Paul Etienne Balze, 1855.

«Des hellénistes et des anthropologues modernes ont vu plutôt dans la tragédie la transformation de rites funéraires». «Je pense surtout à la négation de la vie. Les degrés marqués d'inhibition, la «stupeur dépressive» constituent une mort symbolique. Le mélancholique demeure insensible aux influences extérieures les plus vives comme s'il n'appartenanit plus au monde animé.»
La mort liée à l'immortalité héroïque
«En 1919, Freud conçoit toujours l'angoisse de mort comme un déplacement de l'angoisse de castration. L'immortalité serait au narcissisme ce que la négation de la castration est à la libido d'objet.. encore que Freud commence à soupçonner l'influence possible d'autres facteurs. Il était trop imformé de la clinique psychiatrique de son temps pour ne pas s'apercevoir que le syndrome de Cottard observé dans la mélancolie, les idées de grandeur des démences vésaniques ou de la phase terminale des paralysies générales, ne pouvaient s'interpréter au nom du seul narcissime.»
«En fait, l'introduction de la pulsion de mort modifiait totalement la conception du fonctionnement de l'appareil psychique. On peut en prendre la mesure en comparant les vues de Freud sur la mélancolie à travers deux écrits. Le plus ancien «Deuil et mélancolie», daté de 1915; expose une conception antérieure à la dernière théorie des pulsions.
Les lumières étaient bizarres, inquiétantes. Merveilleuses comme dans une féerie enfantine ou un conte de Noël où la poésie fait une courte halte dans les cœurs des hommes, les lumières mélangeaient le jour et la nuit de manière si étrange que l’angoisse de ne plus appartenir à une terre en révolution autour du soleil en dissipait l’enchantement visuel. Des bandes de couleur verte se découpaient dans la mer sombre sous l’effet de projecteurs célestes multiples, comme si le crépuscule voyait s’abîmer dans la mer plusieurs soleils. La nature avait pris un ton à la fois si vif et si désolé que mes proches voisins de la plage ne se distinguaient en rien les uns des autres. Je suppose que nous étions tous abasourdis par le spectacle sublime et mystérieux de ces lumières, un peu comme le sont les enfants dans les récits naïfs d’apocalypses. En vérité, on aurait dit que les infrarouges et les ultraviolets avaient subitement rejoint, par une de ces métamorphoses radicales de la physique que seul un Dieu peut exécuter, les longueurs d’onde habituelles et rassurantes du spectre visible. C’est bien cela, le spectre lumineux s’était étendu hors de ses marges, de ses confins et avait recruté de nouvelles luminosités.
À ce moment, je vis une main fermée qui se promenait dans le Ciel et rasait à intervalles périodiques la surface de la mer. Le poing volait au-dessus de nos têtes comme un insecte géant ou un avion de combat prêt à larguer ses bombes. Les gens de la plage se tenaient immobiles et silencieux, redoutant peut-être les mouvements de la main fermée. Quelle créature démoniaque pouvait-elle ainsi se rire de l’indolente lassitude qui voue les plaisanciers aux anodins jeux de sable ou aux siestes ensoleillées ? Après quelques minutes, la main disparut du ciel et les hommes soulagés ?semblèrent reprendre le cours ordinaire de la vie. Personne d’entre eux, je suppose, ne souhaitait commenter la chose. La main qui volait ne faisait pas partie du plan de leur vie. Mes voisins reprirent leurs livres et leurs journaux, mais je restais sur mes gardes. Le feu d’artifice et les distractions annexes qui l’accompagnaient n’étaient annoncés que vers minuit et nous étions encore à quelques heures des festivités promises. Malgré le stupéfiant découpage de la mer en bandes multicolores, chacun faisait mine de se distraire et se montrait indifférent à la métamorphose du crépuscule. Du reste, les autorités n’avaient prévu aucune tempête, pas même un coup de vent. On voyait sur la plage les tentes, les parasols et les transats sans protection ni amarrage et cela suffisait à rassurer les baigneurs et les oisifs qui s’attardaient près de la mer malgré l’heure tardive. Avais-je rêvé tout à l’heure en regardant la main gantée dessiner ses acrobaties aériennes ou se pouvait-il que les autorités de la ville aient mis en scène, comme dans un opéra, l’étrange crépuscule qui couchait ses nombreux soleils dans la mer et les admonestations du poing céleste.
En vérité, je crois que l’espèce humaine de la ville balnéaire se soumettait comme ailleurs au savoir-faire des autorités et faisait peu cas des miracles ou des étrangetés qu’on n’annonçait pas dans les programmes officiels. Du reste, la technologie des spectacles municipaux, à l’occasion des festivités estivales, s’enrichissait chaque année de nouveaux artifices dont Moïse aurait rêvé dans les Temps reculés de l’humanité.
Pourtant, la soumission crédule ou le manque de curiosité des autres me surprenait, pire, m’irritait. Etions-nous si sûrs que ce spectacle soit une simple mise en scène contrôlée et régie par les habiles et talentueux machinistes de la ville ? La lumière d’un soleil couchant m’étonna soudainement par sa vigueur et sa clarté. Loin de tendre vers le rouge ou le mauve avant de tomber dans l’eau, le soleil gagna au contraire en puissance, au point que j’en fus aveuglé. La mer sous l’emprise de son intense rayonnement, au lieu de s’iriser de ce scintillement argenté des derniers éclats solaires se teinta d’une couleur vert émeraude d’une splendide et vénéneuse beauté, comme si la nature avait troqué sa splendeur primitive et sauvage contre les ors et les bijoux d’une princesse des mille et une nuits.
Craignant que mes sens ne soient abusés par l’étrange farce surréaliste qui mélangeait de la sorte les midis et les crépuscules, je me tournai à nouveau vers mes voisins de plage, guettant dans leurs mimiques ou leurs propos la naissance d’une perplexité commune. Mais le coucher des soleils ne semblait guère les perturber. L’un d’entre eux, que je connaissais vaguement et qui m’avait aperçu l’après-midi dans le hall de l’hôtel où se tenait notre colloque sur les limites du principe de précaution, me fit un signe poli de la main et reprit son document de travail. Sa conférence du lendemain occupait tout son esprit et ne laissait guère y pénétrer les rayonnements insolites.
Tout à coup, débouchant du ciel à grande vitesse comme un météore, je vis un groupe d’hommes et de femmes se désintégrer à la surface de la mer dans des gerbes d’écume et un fracas d’explosions. Il ne restait rien de cette fresque éphémère sinon une flaque rouge, comme une tâche de sang sur la mer d’huile.
Il se passa à peine quelques instants avant qu’un deuxième groupe n’apparaisse dans le ciel sous les vivats et les encouragements de la foule qui se pressait sur les terrasses surplombant la plage. Il me sembla reconnaître le Radeau de la méduse de Géricault avec ses gens affamés et en guenilles, hissant leurs faméliques silhouettes au-dessus des cimetières marins. C’était bien ça, au fur et à mesure que le groupe chutait à vive allure vers la mer, je découvrais la saisissante reconstitution du tableau. Etait-ce un hologramme formidable, une projection d’images époustouflantes animée par une équipe d’illusionnistes hors du commun ? Tout cela semblait si vrai, si naturel. À nouveau, le choc dans l’eau fut terrible, assourdissant. La mer prit une teinte rouge sang après le choc, les cris et les explosions. Les applaudissements crépitèrent sur les terrasses de la ville balnéaire.
Les fusillés du Tres de mayo de Goya surgirent peu après, dans le halo grimaçant des lanternes, très haut dans le Ciel et entamèrent leur vertigineuse plongée, chassant des esprits les naufragés de la Méduse. Un cri d’admiration fusa des bouches de la foule comme un frisson ou une ola qui soulève d’enthousiasme les publics des stades. J’avais bien aperçu sur les affiches municipales l’annonce d’un spectacle consacré aux grandes peintures avant le traditionnel feu d’artifice de minuit, mais je n’y avais guère prêté attention, las de cette concurrence sans fin des festivals ou des journées thématiques que chaque ville se croyait obligée d’organiser pour gagner un peu de considération et d’argent. Le pays croulait sous l’avalanche de festivals de tous ordres ; chaque cité, fût-elle très petite, se battait contre les autres avec un orgueil plus ou moins mesuré et d’inégales capacités logistiques à la manière de ces seigneurs toscans du Moyen Age qui érigeaient des tours de plus en plus hautes pour affirmer leur pouvoir et leur fortune. À l’hôtel, nous avions eu tout le loisir de consulter le programme des fêtes, mais j’avais eu à cœur de relire mon intervention au colloque. J’avais beau me persuader que tout est dans tout et que rejeter un point de vue sous le prétexte qu’il est hors sujet illustre presque toujours une pauvreté de pensée et un défaut de jugement synoptique, il m’arrivait de douter de la pertinence et de la clarté de mes pensées. Je savais que mon esprit fonctionnait de façon trop intuitive, trop brouillonne et que ce dérèglement fautif de la cadence et de la discipline des arguments me valait l’ordinaire réprobation de mes collègues. J’avais donc révisé mes notes l’après-midi avant d’aller à la plage et tenté d’y mettre un nouvel ordre, tout aussi bancal et approximatif que les précédentes versions et dont l’unique mérite était d’être le dernier né. En sortant de l’hôtel, des fragments de réflexions vagabondes et fébriles sur les nombreux détours de mon exposé m’avaient distrait de la vue des centaines de pancartes qui vantaient le spectacle pionnier de la soirée sur l’art pictural du XIXe et du XXe siècle. Informé de ce fait, je n’aurais pas marqué un tel étonnement à la vue des multiples soleils qui rappelaient les toiles de Monet ou de Mykinès. Maintenant que les astres reposaient dans les profondeurs marines et que l’obscurité avait envahi l’endroit, les compositions éphémères des peintres imprimaient librement leurs foudroyantes beautés visuelles chez les spectateurs.
Mais à quoi bon ces cris, ces tourments, ces détonations qui suivaient la chute des fresques dans l’eau ? Je restai songeur et mal à l’aise face à cette débauche de moyens optiques et de pétarades assourdissantes.
La mer, à l’endroit où les projecteurs suivaient la chute des tableaux, avait la couleur charnelle et ferreuse du sang, une couleur rouge sombre, viscérale, écorchée, la couleur des bœufs dépecés de Rembrandt ou de Soutine. Un nouveau groupe illumina le ciel, aussi clair qu’une étoile filante ou que la queue argentée d’une comète : « L’entrée du Christ à Bruxelles » de James Ensor avec ses fanfares, ses masques, ses hurlements, sa foule sinueuse, bavarde et ondulante, où l’on devine au fond, perché sur sa monture d’âne, Jésus. Les banderoles sont là aussi, Vive la Sociale, Vive Jésus, roi de Bruxelles.
- Mon Dieu, mon Dieu !.. Est-ce possible ? Faites que cela ne soit pas vrai. Pas lui, je vous en supplie. Je me retournai et vis le visage en pleurs d’une jeune femme.
Oh non pas lui, c’est son tour, je le sais. On lui a fait mettre la tunique rouge du Christ. Et maintenant il va mourir ! Mon Dieu, mon dieu, tout est fini, tout est fini…
- Mais qui prie-t-elle ainsi, me demandai-je. Le Jésus du tableau d’Ensor perdu au milieu des masques ?
- Ne vous sentez-vous pas bien, Madame ? Tout cela est saisissant, affolant même, j’en conviens, mais ce n’est qu’un prodige technique, une sorte d’hallucination optique. Je vous promets qu’on ne va pas tuer Jésus aujourd’hui une seconde fois.
- Hélas, Monsieur, hélas si, cet homme qui est monté sur l’âne n’est autre que l’homme que j’ai aimé, et que l’on va exécuter aujourd’hui, fagoté avec les autres, tous promis à un terrible trépas. Tout cela est vrai, horriblement vrai. Nous sommes damnés ! La mer, la mer va se soulever et nous engloutir. Nous sommes des porcs, des barbares, moins que des bêtes. Et Dieu n’écoute plus nos prières.
- Mais enfin, Madame, vous perdez la raison. Ce spectacle est grotesque, je vous l’accorde. Il est morbide et racoleur. Il offense sans aucun doute le bon goût et met à mal l’idée que des âmes sensibles se font des chefs-d’œuvre de la peinture. Mais ne sommes-nous pas déjà résignés à cette tapageuse et gigantesque braderie des arts ? Bach et Mozart servent aujourd’hui dans les supermarchés ou les halls de gare à distraire notre impatience et nos mouvements d’humeur. Pourquoi en serait-il autrement avec la peinture ? L’œuvre d’art à l’âge de sa reproductibilité technique. D’estimables penseurs du siècle dernier en avaient prophétisé les pires débordements marchands. C’est triste, regrettable et par certains aspects d’une monstrueuse vanité. Mais pourquoi en serions-nous à ce point terrorisés ? Ne pouvons-nous pas en rire, tout simplement, Madame ?
- Vous ne comprenez pas, Monsieur, vous ne comprenez pas la malédiction qui va frapper la terre, qui va nous frapper tout à l’heure. La mer va se soulever. J’en suis sûre ! Et elle punira, elle anéantira ces spectateurs, vous, moi qui sommes venus assister à l’exécution.
Je ne répondis pas sur le champ à la jeune femme. Malgré les mimiques de terreur qui déformaient son beau visage, j’avais le sentiment qu’elle succombait à un démon intérieur ou à une crise de folie qui lui découvrait un autre monde d’une indicible cruauté. Mais sa terrible conviction que ce spectacle donné dans la moiteur d’une soirée estivale n’était pas une mise en scène extraordinairement réussie, mais une authentique exécution collective, ce pressentiment absurde commençait à semer la désolation et le trouble dans mon esprit.
Je me retournai vers la jeune femme qui laissa échapper un sinistre cri au moment où le Christ de Bruxelles et sa foule de compagnons masqués et grimaçants se volatilisa au contact de l’eau comme une masse humaine ceinte d’une gigantesque ceinture d’explosifs. La jeune femme pleurait maintenant et chuchotait des mots insensés sur la mer révoltée, sur la vengeance des flots rouges. Des mots insensés, hoquetés dans la douleur et la lamentation et qui n’avaient plus cours dans notre monde du principe de précaution maximale dont la raison d’être principale était d’alléger les souffrances de la condition humaine. En d’autres circonstances, je me serais moqué de ses airs absurdes de fausse prophétesse et de sa manie enfantine de convoquer la vengeance divine contre les folies humaines, mais son angoisse démoniaque me troublait. Et j’en vins à me demander fiévreusement si sa détresse théâtrale que je tenais encore tout à l’heure pour le fruit d’une imagination maladive n’avait pas des causes bien réelles. Je la suivis des yeux quand elle se leva et marcha en direction de la mer. Je me levai aussi et emboîtai ses pas.
- Madame, Madame, lui dis-je en hâtant l’allure afin de me retrouver à ses côtés, que voulez-vous suggérer, que ces tableaux ne sont pas des compositions artificielles mais bien des assemblages d’hommes que l’on envoie de la sorte à la mort ?
- C’est l’exacte vérité, me répondit-elle, mais maintenant cela n’a plus d’importance. La vengeance du ciel approche. Nous sommes des monstres.
- Mais enfin, Madame, vous ne pouvez croire à des sornettes pareilles. La fin du monde, c’est le cauchemar des hommes de l’Age technique. Malgré nos exterminations de masse, les hommes continuent de croître et de se multiplier sur la planète. Nous vivons encore avec les angoisses d’une espèce rare alors que nous sommes dorénavant dans le temps de l’abondance humaine.
- Venez-voir la mer, me dit-elle, la mer ne ment pas. Elle me prit la main. Je ne savais pas s’il s’agissait là d’un geste de défi ou de tendresse. Je suis complètement fou, pensai-je, je suis cette jeune femme qui est la proie d’un délire mystique et qui en veut au monde entier d’avoir tué à nouveau Jésus. Mais sa main suppliante et moite qui serrait mes doigts me guidait vers la mer, et je ne résistais pas. Je pensai au tableau de Bruegel le Vieux montrant une file d’aveugles suivant sans malice le premier d’entre eux qui avait chuté dans une mare. La belle jeune femme possédée par son mystère me tirait vers la mer et je la suivais, docile, résigné aux pires révélations.
Nous arrivâmes au bord de l’eau et nous sentîmes sous nos pieds la succion désagréable de vaguelettes chaudes et poisseuses.
- Regardez, regardez l’eau. Elle est rouge ! Elle est rouge parce que c’est du sang, le sang de tous ces suppliciés qui ont diverti vos yeux…
Je me penchai et aussitôt, je fis un bond en arrière. Je reculai d’effroi devant cette terrible, cette inimaginable découverte. L’eau de mer avait la teinte et l’odeur du sang.
Je balbutiai à la jeune femme des mots inintelligibles. Elle ne m’écoutait plus. Sa beauté sombre et sépulcrale se montrait désormais indifférente à l’univers des hommes. Courbée dans une prière à la mer, elle semblait avoir quitté le monde des vivants. Je la laissai à son recueillement et remontai la plage en courant. La jeune femme avait raison. Tout cela est vrai, horriblement vrai.
On annonçait maintenant la couronne finale avant le début du feu d’artifice traditionnel qui était toujours prisé par un public conservateur, qu’agaçaient les spectacles originaux et insolites.
J’ai blotti ma tête dans les mains et j’ai essayé de faire le vide, de ne plus penser, d’imaginer que j’étais en proie à un délire, à une machination des sens déréglés par l’abus d’alcool. Hélas, je n’avais pas bu grand-chose. Je voulais fuir, me réveiller ailleurs, repousser les parois du cauchemar, mais j’entendais encore les cris rauques et affolés de la jeune femme et je sentais sur mes doigts le parfum fade et visqueux du sang.
Des applaudissements nourris et enthousiastes saluèrent la fin imminente de la rétrospective picturale.
Et je me pris à méditer anxieusement : savent-ils, tous ces hommes, mes voisins de la plage ou ceux des terrasses, peuvent-ils savoir que ces peintures si vives, si étrangement réalistes ont été exécutées dans la chair de dizaines de condamnés. Ou bien s’en accomodent-ils comme d’un moindre mal ? A l’opposé des exécutions sombres et épouvantables d’autrefois avec leurs autodafés et leurs guillotines aux ciseaux coupants, et démodant les injections mortelles ou les pendaisons des temps barbares, de telles mises à mort ne manquaient pas d’atouts à faire valoir : l’éducation artistique des masses n’y trouvait-elle pas un inattendu soubresaut et le frisson supplémentaire propre à marquer les mémoires des plus oublieux ? N’avait-on pas de la sorte sacrifié de nombreux animaux dans des installations prestigieuses d’artistes contemporains, sans que personne n’y trouvât à redire ? Les arts ne faisaient que rejoindre les sciences !
Et puis l’opinion publique, du moins ce que l’on nomme ainsi, cette sorte de monstre arithmétique impalpable qui a opinion sur tout, si elle peut s’émouvoir de la sauvagerie des mises à mort, de leur cruauté, de leur froide et inhumaine mécanique est dans une certaine mesure épargnée par ces élégantes exécutions qui respectent la délicatesse et la fragilité des publics. N’a-t-on pas sermonné à l’opinion que tout écart à la règle, à la Loi, si minime, si futile soit-il, est un accroc à l’hygiène collective des peuples, qui du coup, cherchant dans leurs antiques manières de vivre des crimes et des fraudes, s’épient, se surveillent, parfois se dénoncent ? Je jetai un coup d’œil circulaire aux hommes des terrasses et de la plage. Personne ne semblait décontenancé ou honteux. Que faisais-je moi-même en ce lieu vaniteux où l’exécution ignominieuse des condamnés avait atteint une telle intensité, un tel rayonnement de beauté macabre ?
L’homme n’est pas simplement un loup pour l’homme, pensai-je. L’homme n’aime plus l’humanité. Il cherche par tous les moyens à s’en émanciper. Je ne sais pas s’il désire vraiment l’immortalité ou s’il rêve fugitivement de l’acheter comme on va faire un plein de provision dans les grands magasins. Il ne croit pas à une immortalité héroïque ou divine. L’homme, chacun de nous, a simplement peur, peur de mourir, peur de quitter la terre alors que les autres restent là, plus longtemps, plus injustement. Si on lui offre des vies plus longues, si l’hygiène de tous accroît le potentiel de vie de chacun, alors il consent à se discipliner, à brider sa violence, son dégoût, ses colères. Il se range parmi les autres, presque indifférent, spectateur épuisé de la destruction des hommes lointains, songeant mélancoliquement et avec une joie pâle et indicible à la fin du monde. L’homme n’aime plus l’humanité.
L’homme ne respecte plus Dieu ou la Création dans le visage du voisin. Il déteste dans son voisin cette lourdeur de traits, ingrate, obèse ou flétrie, qui s’acharne à survivre, à durer ; il déteste ses manies, sa précipitation, sa docilité ou sa rage feinte, sa présomption de créature éphémère qui a un faible pour les durées infinies. Si l’homme, le glébeux a été créé à l’image de Dieu, selon sa ressemblance, comme son exacte réplique, ainsi qu’il est dit dans la Genèse, alors quelle gueule a Dieu ? Cette question ne manquait pas de me faire sourire, chaque fois que je pensais à la face de l’Eternel contemplant avec effroi, et comme une terrible blessure narcissique, ses créatures terriennes. Du reste, Il s’était employé à les raser de la surface du Monde, mais quelques justes avaient eu raison de Sa colère et Dieu passait le reste de sa vie à fuir le monde où ses reflets, ses images lui causaient un si amer et violent dégoût de Lui-même. Et les plus grossiers ennemis de Dieu, ceux qui Lui rappelaient à longueur de journée sa méprise et le contraignaient à un long exil, n’en finissaient pas de causer des malheurs aux autres hommes en scandant Son nom à tout bout de chant et en suivant à la lettre Ses décrets. Dieu n’avait pas d’autre choix que la fuite. L’homme n’aime plus l’humanité ! répétais-je intérieurement. Sinon, comment laisserait-il faire ces exécutions grotesques, comment peut-il les regarder comme une distraction amusante et éducative ? Je devais en tenir compte pour mon intervention au colloque. Le principe de précaution qui régissait les mœurs dans de très nombreux domaines s’arrêtait à la porte des prisons. La pendaison d’un homme au pénitencier, dans le silence complice d’une sale aurore, passait pour un acte de barbarie sociale, le retranchement brutal et infâme d’une vie humaine. Mais ici, on mourait en beauté, en serviteurs des plus nobles élévations de l’esprit, en fulgurantes images de l’Art offertes à tous. Je songeai au mot d’Imre Kertesz : Des rubans sur la hache des bourreaux…
Alors que je m’efforçais de comprendre la prouesse technique qui avait permis de lancer dans le Ciel des compositions humaines si complexes et abouties, je vis mes voisins replier leurs chaises de plages et leurs journaux.
Une animation bruyante et confuse avait saisi les gens de la plage qui se hâtaient en chœur de plier leurs affaires de bain. Le vent s’était levé et par bourrasques d’abord brèves et claquées, puis de plus en plus soutenues et violentes, soulevait des nuages de sable. J’abritai mes yeux derrière une serviette. Les tentes arrachées de leurs piquets volaient comme des oiseaux affolés sur la plage que fuyaient maintenant dans une cohue anarchique les spectateurs dociles et attentifs de l’exécution. Un avis de forte tempête circulait dans les haut-parleurs et recommandait aux gens de se mettre rapidement à l’abri.
Alors, je la vis grossir peu à peu, comme un monstre surgi des abysses. La vague, une vague énorme, haute comme des gratte-ciel, charriant sur sa crête ondulante et rouge les corps déchiquetés des trépassés. Une immense vague de sang prête à déferler sur la ville et à aspirer en ses entrailles son tribut, cette masse de corps encore mobiles et paniqués qui se bousculaient en tous sens. La vague enflait toujours. Elle avançait lentement, sûre d’elle-même, confiante en sa justice de vague qui roule, se brise et se retire au loin avec ses milliers de noyés, sa nourriture des tempêtes. Je ne pouvais plus bouger. La mer rouge me faisait face. Je serrai instinctivement mes notes sur la conférence du lendemain comme si elles m’accrochaient encore à un avenir, à un lendemain ordinaire et serein. Mais la vague approchait, gigantesque mur d’eau souillée de sang qui roulait, dédaigneuse et impitoyable, sans jamais se casser vers la grève. Elle avait le temps !
La vague, la vague… La mer dressée dans une colonne d’eau gigantesque arrivait. Je sentais son souffle de fauve, sa gueule grande ouverte et affamée…
Non, tout cela n’est qu’un cauchemar, réveille-toi, réveille-toi. Tu n’es pas sur la plage. La vague de sang n’existe pas. Un simple rêve !..
Nous avons le plaisir d’accueillir le docteur… je crus entendre mon nom…, qui va nous parler des dérives et des vices du principe de précaution dans les urgences vitales. Docteur, c’est à vous. Mais je ne bougeai pas. J’avais sans doute égaré mes notes sur la plage quand la vague s’est levée. Je ne me sentais pas du tout en état de parler d’un tel sujet. Je n’en comprenais pas le sens. Je devais me lever, dire quelques mots, faire semblant d’avoir là-dessus une opinion fondée et éclairante. Mais la jeune femme qui baignait sa douleur dans les flots rouges se tenait encore près de moi, pareille à Andromède qui attendait, ligotée à son mât, la venue du monstre marin.
Je crus entendre une nouvelle fois mon nom, était-ce mon nom, qu’un micro inamical amplifiait avec des accents de remontrance et de mise en demeure. Et une nouvelle fois, on cita publiquement mon nom et le titre de mon exposé.
Je ne bougeai pas, la jeune femme non plus. Les corps des suppliciés du Tres de mayo naviguaient comme des épaves de bateaux grignotées par le sel sur le faîte de la grande vague.
C'est à vous, il faut y aller, semblait dire une voix proche et bienveillante ; mais je ne pouvais quitter les yeux de la muraille d’eau rouge qui déferlait lentement, lentement sur notre plage et engloutirait prochainement la cité et ses conférenciers. Personne ne la voyait. On dissertait doctement, imbécilement sur le principe de précaution et chacun détournait sa face du désastre imminent.
Maintenant je la voyais de haut, la vague rouge, maintenant que j’étais suspendu au filin d’acier du dernier tableau, très haut, dans l’obscurité étoilée de la nuit et que c’était à mon tour de finir en beauté, en artiste… en hommage éviscéré à la grande peinture. On m’avait muni d’un grand bâton tout comme l’autre homme en face de moi, que je ne connaissais pas, amarré à un autre cordage métallique. Nous échangions des coups, monstrueux énergumènes d’un duel qui nous enlisait plus profondément dans la moite noirceur du ciel. Quand nous fûmes projetés vers la mer, sous l’aveuglante clarté des projecteurs, nous nous frappions encore, machinalement, autant pour nous protéger des lumières féroces qui fouillaient nos silhouettes que par souci de parer les attaques de l’ennemi. Ennemis ? Dans quelques secondes, nos corps volatilisés nourriraient comme des vers la vague rouge qui enflait. Ennemis ? Qu’avions-nous fait ?
La couronne finale. Je faisais partie de la couronne finale. Un honneur, un privilège, tout comme m’avait distingué parmi d’autres confrères aussi compétents l’invitation au colloque. Nous sommes des monstres ! J’entendis la voix de la jeune femme au moment où mon corps heurta la muraille d’eau rouge. J’eus l’impression d’être pareil à ces petits poissons qui disparaissent dans le ventre insatiable des requins et je songeai que, chaque heure, chaque jour qui passent, les monstres alimentent, fortifient, nourrissent la vague qui me noie…